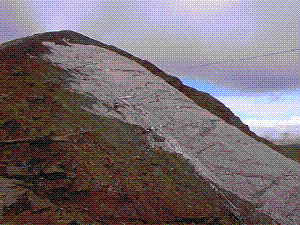Etude des carottes glaciaires et archéologie
| Institut |
Orstom (Institut français
de recherche pour le développement en coopération) : programme
NGT (Neiges et Glaciers Tropicaux) |
Brüning Museum, Pérou
et USIS (United States Information Service) |
| Chercheurs |
Bernard Francou et Bernard Pouyaud |
Walter Alva |
| Pays |
France |
Pérou et USA |
| Outil d'étude |
Carottes glaciaires |
Côtes du Pérou :
fossiles de poissons, crustacés, mollusques |
| Lieu |
Pérou |
| Publication de l'étude |
Le Monde, 6 juillet 1997 |
Le Monde, 16 avril 1998 |
| Position (lien entre El Niño
et le réchauffement) |
Le réchauffement renforce
El Niño |
Un climat plus chaud et plus
humide a entraîné la disparition d'El Niño |
Les carottes de glaces
Principe
Les glaciologues prélèvent des carottes jusqu'à des profondeurs
de 2000 mètres sur les grandes masses de glace formées par les
précipitations de neige qui s'accumulent chaque année au Groenland
ou en Antarctique, en emprisonnant de l'air. L'analyse physico-chimique de ces
carottes de glace permet d'obtenir des informations sur les conditions climatiques
au moment de leur dépôt. En particulier, le rapport d'abondance
entre l'isotope lourd de l'oxygène 180 et l'isotope léger 160
est d'autant plus grand que la température des océans qui ont
donné naissance aux précipitations est plus élevée.
L'âge des couches peut être évalué par comptage des
strates annuelles. On peut ainsi dessiner l'évolution du climat terrestre
au cours des 400 000 dernières années.
Le phénomène ENSO accélère la fonte
des glaciers tropicaux andins, provoquant une hausse de la température
de la troposphère et la diminution des précipitations. Ces
glaciers sont particulièrement sensibles aux anomalies climatiques
et constituent des témoins extraordinaires des variations des dernières
décennies, voire de plusieurs siècles et les indicateurs les
plus fiables du réchauffement global de la Terre.
Résultats
|
Les 2 chercheurs de NGT ont mis en place depuis 1991 un réseau
d'observation sur les glaciers du Zongo et de Chacaltaya installant des
stations météorologiques et divers dispositifs. Les carottes
prélevées dans la glace permettent de déterminer
avec précision l'abondance des précipitations des dernières
décennies, mais aussi un calendrier de l'influence du Niño
depuis des millénaires.
Depuis le début des années 1980, on observe une fonte générale
et accélérée des glaciers andins. Les résultats
des travaux "montrent que le recul mesuré a été
trois fois plus rapide après 1980 que dans la décennie antérieure
au Pérou. En Bolivie, il a été cinq fois plus rapide
que pendant les quatre décennies précédentes."
D'autre part, les carottes glaciaires permettent la mise en évidence
du réchauffement climatique par l'analyse des bulles de gaz piégées
dans la glace, ce qui montre qu'un réchauffement plus important
est bien à l'origine de l'augmentation de la fréquence et
de l'amplitude des phénomènes ENSO.
|
|
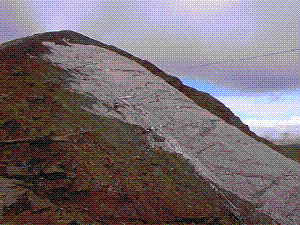
Le glacier de Chacaltaya (Bolivie) après l'événement
El Niño de 1997/98
|
L'archéologie
Les traces laissées par les inondations sur les monuments
anciens situés au Pérou tels que le monument de Sechin, de la
vallée de Casma, ceux de la Salinas de Chao ou le centre cérémonial
de Purulen, ainsi que les empreintes laissées dans la géomorphologie
du désert montrent que les effets dévastateurs d'El Niño
se sont fait sentir depuis près de 4000 ans. Walter Alva, l'archéologue
Péruvien, a ainsi étudié les civilisations Mochica et Lambayeque
et a montré que leur disparition était liée a des mégas
El Niño.
Cette théorie a été confirmée par
des géologues et archéologues Américains. Ceux-ci ont déduit
par l'analyse et la datation de restes fossilisés de poissons,
crustacés et mollusques tropicaux envahissant les côtes du Pérou
lors du réchauffement des eaux occasionné par El Niño,
que ce phénomène climatique n'avait pas "fonctionné"
pendant 3000 ans, au milieu de l'Holocène, au cours d'une période
comprise entre - 8000 et - 5000 ans, car il n'y a pas eu de fossiles retrouvés.
Selon eux, cela serait dû au fait que le climat terrestre était
plus chaud et plus humide que de nos jours et le premier El Niño
aurait été enclenché par un changement climatique marqué,
survenu il y a 5000 ans.
Ainsi, un réchauffement de la planète conduirait
à la disparition des El Niño, à l'image de ce qui s'est
passé pendant l'Holocène.